Regard sur une carrière scientifique
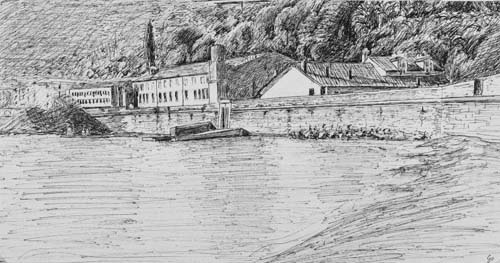
1. Historique
En 1957, le recrutement dans l'Enseignement Supérieur relevait encore des affinités entre un professeur et son élève. Etudiant, j'ai été attiré, puis fasciné par les cours de Jacques Bourcart, sans doute parce que le professeur apprenait à ses élèves ce que doit être l'esprit critique, en mettant systématiquement en question les idées reçues et les théories du moment. Ses refus rencontraient les miens. Plus encore que le géologue, c'est le non-conformiste que j'étais prêt à suivre. Fort opportunément, un poste d'assistant se trouva libre dans son service alors que j'achevais mes études universitaires et mes années d'École. Sans réelle concurrence, j'y fus nommé, et ainsi récompensé de l'admiration que je portais à mon maître autant que de mes modestes débuts dans la recherche géologique un an plus tôt. À cette époque, les postes libres étaient très rares à la Faculté. J'avais 24 ans, et beaucoup de chance.
Commença une période d'intense travail personnel. Comme assistant, j'avais la lourde charge d'un enseignement de sédimentologie presque entièrement nouveau, qui attira très vite une centaine d'étudiants chaque année. Et comme jeune chercheur, j'avais bousculé à mon tour les usages en définissant moi-même le sujet de ma thèse d'État, la géologie de la Manche occidentale, ce qui m'imposait de travailler plusieurs mois par an à la Station biologique de Roscoff et sur son petit navire de recherche, le Pluteus II (17 m). Je me souviens des lettres que m'adressait à cette époque J. Bourcart, de Paris ou de Villefranche-sur-Mer où il passait les mois d'été, pour me reprocher avec quelque amertume mes séjours en Bretagne beaucoup trop longs à son goût, et me dire sa déception de voir son disciple préférer son activité personnelle à la collaboration et à la présence qu'il avait espérées en me recrutant. C'est que je devais faire vite, face à deux échéances toutes proches : celle de mon service militaire, de 1961 à 1963, et celle du départ en retraite de mon maître, qui ouvrait pour moi une période d'incertitude.
Ma thèse d'État était en effet écrite et prête à l'impression en 1963. Mais L. Glangeaud avait alors succédé à J. Bourcart à la tête du laboratoire où je travaillais, et entendait bien à la fois changer mon orientation scientifique et rompre les liens de fidélité qui m'attachaient à son prédécesseur. Face à cette double exigence, je ne pouvais que me rebeller. Le plus difficile pour moi dans ce conflit très dur, qui se prolongea presque trois ans, fut l'inégalité des armes. En ce temps là, le maître-assistant que j'étais ne disposait d'aucune tribune pour répondre aux accusations d'un puissant professeur de Faculté, qui avait au contraire accès à toutes les instances dont dépendait mon avenir. Rien d'étonnant à ce que, quelques années plus tard, le jeune professeur soixante-huitard votât avec jubilation l'abolition de privilèges dont il avait douloureusement éprouvé la nuisance. Ce fût G. Millot qui me tira de ce mauvais pas, en dénonçant la mauvaise foi de mon persécuteur et en imposant enfin mon inscription sur les listes d'aptitudes indispensables à la poursuite d'une carrière normale.
( Retour )
En me laissant enfermer dans ce conflit stérile, j'avais certes perdu un temps précieux, qui aurait sans doute mieux servi à des activités scientifiques. Mais la crise eut aussi des conséquences bénéfiques. Obligé de réfléchir sur les ressorts intimes de mon activité de chercheur, je pouvais désormais mieux comprendre les attentes de mon entourage, et éviter ainsi bien des erreurs au futur directeur de laboratoire que j'allais devenir. Et surtout, libre d'une partie de mon temps puisque les moyens de la recherche m'avaient été retirés, j'avais tenté d'échapper à mon anxiété en faisant l'apprentissage d'une écriture plus littéraire que scientifique. Revenu, un peu plus tard, à une activité professionnelle normale, j'ai tiré grand profit de cette expérience, quand il s'est agi de rédiger articles, rapports, propositions de recherche à quoi nous passons tous beaucoup de temps dans notre métier. La facilité à écrire, je l'ai acquise au temps où L. Glangeaud m'avait contraint au chômage technique, quand l'écriture était devenue pour moi un refuge protecteur contre la dépression.
Je crus atteindre le bout du tunnel en 1967, lorsque je fus nommé professeur à Rennes (on disait alors : maître de conférences). À 33 ans je pouvais enfin fonder un laboratoire, rassembler une petite équipe d'étudiants et de jeunes chercheurs et diriger leurs thèses. Mais une nouvelle difficulté surgissait bientôt : c'est à Brest, et non à Rennes que le CNEXO, le nouveau et tout puissant tuteur de la recherche océanologique française, avait décidé d'implanter ses équipes de recherche, en favorisant l'université de proximité. Je n'avais donc plus aucun avenir là où je venais de m'installer. Dès la fin des années 60, mon départ de la capitale bretonne était donc inéluctable.
Toutefois, les sept années que j'ai passées en Bretagne comptent parmi les plus fructueuses de ma carrière. C'est alors que nous avons entrepris et mené à bien, en collaboration avec R. Horn et le BRGM d'abord, avec le soutien financier du CNEXO ensuite, et bientôt en coopération avec une vaste équipe « hors murs » de géologues, la cartographie géologique de la plateforme continentale française. L'entreprise, dont je fus le coordinateur, s'acheva presque dix ans plus tard par la publication des premières cartes géologiques au 1/1000000 de la Manche et de la plate-forme continentale armoricaine et aquitaine. Aujourd'hui, les deux cartes sont reprises pratiquement sans changement dans la carte géologique de la France au 1/1000000, et donnent de la Géologie de notre pays une image autrement plus fidèle qu'auparavant, quand les couleurs représentant les terrains s'arrêtaient au trait de côte.
Comparés à ceux de notre voisin de Brest, les moyens dont nous disposions à Rennes pour nos recherches en mer étaient pourtant bien modestes et inconfortables. Le Job Ha Zélian, notre principal support nautique, était un court chalutier de 22 m, malpropre et malodorant, qui ne pouvait travailler efficacement que sur la plate-forme continentale du Golfe de Gascogne ou de la façade occidentale de l'Ibérie. Mais la chance nous favorisa : en 1969, nous découvrions, au-delà du chantier cartographique français que je viens d'évoquer, les prolongements submergés de la zone nord-pyrénéenne sur le plateau continental cantabrique et asturien, ce qui ouvrait bientôt la voie à de multiples développements théoriques et économiques. Un succès spectaculaire qui faisait de l'équipe rennaise non pas un concurrent de celle du CNEXO, mais un petit groupe avec lequel il fallait désormais compter. Le laboratoire dirigé par L. Glangeaud, partagé entre Paris et la Station marine de Villefranche-sur-Mer, était certes orienté comme le nôtre vers la géologie marine ; mais il était alors en rapide déclin du fait de l'âge et du comportement de son chef. Nous pouvions ainsi revendiquer, sinon la place du principal laboratoire universitaire français en Géosciences marines, du moins celle d'une jeune équipe porteuse d'avenir. Et c'est sans doute en raison de ce statut flatteur que je fus appelé en 1974 à succéder à celui qui avait tout fait quelques années plus tôt pour arrêter mon élan.
( Retour )
Même délabré depuis les événements de mai 68, l'empire de L. Glangeaud était encore très étendu, et il n'était pas question pour moi de l'hériter sans partage. Instruit par l'expérience rennaise, j'ai souhaité dans un premier temps réunir des chercheurs motivés, pas trop nombreux, rassemblés autour d'objectifs scientifiques précis. Ainsi succéda à celui de Rennes le nouveau « Groupe d'Etude de la Marge Continentale », regroupant une douzaine de chercheurs, certains venus de Bretagne, d'autres de Paris ou de Villefranche, et répartis entre le campus de Jussieu et la Station azuréenne. Aussitôt associés au CNRS, nous pouvions alors déborder des plates-formes continentales où nous étions confinés jusque là par la faiblesse de nos moyens, et commencer à explorer la marge continentale tout entière, en Méditerranée occidentale ou dans le proche Atlantique : le renforcement de notre groupe, assisté d'une solide équipe technique, l'accès aux nouveaux navires de l'IFREMER, le successeur du CNEXO, désormais gérés d'une manière mois hégémonique que naguère, justifiaient et permettaient une nouvelle ambition.
Les expériences acquises à Rennes et à Villefranche autant que la nature des marges bordant les mers alors à notre portée expliquent notre spécialisation initiale dans l'étude des marges océaniques stables. De longue date, les canyons sous marins et les deltas profonds étaient étudiés par M. Gennesseaux et G. Bellaiche en Mer Ligure ; dès 1971, l'image sismique enregistrée sur le « Banc Le Danois », au Nord de l'Espagne, nous avait suggéré le concept de bloc crustal basculé au moment du « rifting » : cet héritage donnait à notre équipe une certaine légitimité pour faire des « marges stables d'arrachement » notre principal objet d'étude, plutôt que les zones de subduction ou l'océan ouvert sur lesquels travaillaient alors les chercheurs de l'IFREMER. Ce n'est que plus tard, en Méditerranée centrale et orientale et dans le Golfe de Guinée, que des marges actives ou des marges passives installées sur d'anciennes failles transformantes furent ouvertes aux recherches du groupe sous l'impulsion de Jean Mascle.
Le prestige d'une position parisienne élargit fatalement les responsabilités, qui, de locales ou régionales, deviennent vite nationales. Je n'ai pas échappé à cette loi de notre système centralisateur. En 1975, la communauté française des géologues et des géophysiciens marins était encore petite et dispersée, du moins dans l'espace universitaire. Il était urgent de la rassembler et de la développer, ne serait-ce que pour relever le défi international des forages océaniques profonds. Avec J. Aubouin, X. Le Pichon et plusieurs autres, je pense avoir été l'un des acteurs de cette mutation. Mon rôle à cette époque fut d'animer au plan national le premier programme international de forage océaniques (IPOD), de populariser le concept de marge continentale des océans en publiant mon premier livre d'enseignement, enfin de mettre en évidence pour la première fois des « paléomarges » dans une chaîne plissée : les Pyrénées. À la fin du vingtième siècle, quel que soit le mérite des uns et des autres dans la conversion de notre communauté à la tectonique des plaques et à la collaboration internationale, la France occupait avec la Grande-Bretagne, après les U.S.A., le second rang mondial dans la recherche océanologique en Géosciences. Nous n'en serions pas arrivés là si l'élan n'avait pas été pris dans la seconde moitié des années 1970.
Le jeune Groupe d'Etude de la Marge Continentale, toutefois, devait encore franchir bien des obstacles avant de parvenir au rang international qu'il ambitionnait. La principale difficulté était d'ordre technologique : les puissants moyens géophysiques nécessaires à une « imagerie » complète des marges continentales étaient à cette époque entre les mains des compagnies pétrolières et de l'Institut Français du Pétrole. Or l'IFP, le bras scientifique de ces compagnies, décidait au milieu des années 80 d'abandonner la recherche « offshore ». Du même coup s'ouvrait aux équipes universitaires, et à notre laboratoire en particulier, un large espace auparavant protégé. Non seulement les données acquises par les pétroliers et l'IFP devenaient en grande partie accessibles, mais nous pouvions, grâce à l'IFREMER qui héritait les outils de l'IFP, améliorer considérablement la qualité des images sismiques recueillies en eau profonde. Les portes des programmes internationaux de forages océaniques pouvaient désormais être forcées par une équipe universitaire comme la nôtre. Le saut n'était d'ailleurs pas seulement technologique : il fallait aussi un transfert d'expérience dans l'interprétation des données sismiques. Un transfert en grande partie assuré dans notre groupe par A. Mauffret, qui avait longtemps collaboré avec les chercheurs de l'IFP.
( Retour )
Depuis 1978 cependant, le centre de gravité du Groupe d'Etude de la Marge Continentale s'était déplacé à Villefranche, près de Nice, où j'avais été affecté après quatre ans seulement passés sur le campus de Jussieu. Ainsi, la moitié de ma carrière s'est-elle déroulée loin de Paris et de ses centres de décision, mais dans un environnement scientifique et humain stimulant et chaleureux. Ma production scientifique et celle de l'équipe que je dirigeais y ont certainement gagné. C'est en tout cas lorsque j'étais en poste à Villefranche que nous avons découvert les affleurements de terrains mantelliques qui ceinturent la marge continentale occidentale de l'Ibérie, et défini les « fonds sous-marins du troisième type » constitués de péridotite serpentinisée.
Jusque là, j'avais éprouvé la naïve fierté d'être le plus jeune de ma génération dans les fonctions que j'occupais. Mais la roue tournait pour moi comme pour les autres. La première fois où je fus atteint par une limite d'âge, comme on dit, ce fut à 53 ans, en 1987, après 13 ans de direction du Groupe d'Etude de la Marge Continentale. Il fallait passer la main (J. Mascle me succéda pendant 6 ans), et rechercher un autre terrain d'activité. Je crus d'abord le trouver à l'IFREMER, devenu au fil des ans le précieux et efficace bras armé de la recherche océanologique française. En entrant dans la Grande Maison comme conseiller, je pensais avoir les moyens de peser sur ses choix de politique scientifique. En réalité, je fus confiné dans un rôle de gestionnaire, pratiquement sans espace de liberté. L'expérience, trois ans à peine, m'a laissé un arrière goût d'échec et de déception, mais aussi une certitude : la liberté universitaire est un bien précieux, qu'il ne faut pour rien au monde échanger contre le confort d'un EPIC.
La Société Géologique de France fut un terrain d'action plus à mon goût. J'y retrouvais tout à la fois ma liberté de proposition et d'initiative et les obstacles humains ou financiers auxquels j'étais accoutumé dans la vie des laboratoires. À notre vieille Société savante il faut un président réformateur tous les 10 ans. Je pense avoir été un de ceux-là.
Entre temps, le cap des 60 ans était franchi. Désormais, les campagnes à la mer m'étaient interdites, à la suite d'un incident cardiaque. Fallait-il en rester là ? Avant de quitter la maison à 66 ans, j'ai voulu la mettre en ordre : d'abord en remaniant profondément les locaux dédiés aux Géosciences marines à Villefranche ; mais surtout en fédérant toutes les équipes de Géosciences œuvrant sur la Côte d'Azur, à Nice, à Sophia-Antipolis et à Villefranche, et en les réunissant dans un ensemble sans mur mais unifié, le Laboratoire « Géosciences-Azur ». Le nouveau laboratoire accédait ainsi à une ambition et à des moyens considérablement augmentés par rapport à ceux des petites équipes qu'il absorbait. J'ai voulu aussi que mon enseignement perdurât quelques années encore au travers de deux nouveaux livres. Mais la date de la retraite ayant sonné, j'ai mis un point final à toute activité de géologue et d'universitaire, convaincu que notre métier ne peut s'exercer avec fruit sans les moyens et les responsabilités qui en sont les instruments.
2. Animation scientifique et enseignement
Dans une activité de professeur, l'animation scientifique et administrative est peut-être la part la moins facile à présenter, parce que ses résultats sont difficiles à évaluer. Doit-on énumérer les tâches de directeur de laboratoire, de président de comité scientifique ou de Société savante ? Les innombrables participations aux conseils d'Université, d'Unités de recherche et d'enseignement, de laboratoire, aux commissions de spécialistes ? Au Comité consultatif des Universités, aux commissions du CNRS, aux comités créés autour des programmes nationaux ou internationaux, dont les acronymes ont cent fois changé au cours des années ? Ou bien encore aux réunions des commissions spécialisées mises en place par l'IFREMER ? Faut-il détailler les interventions dans les comités de lecture, l'organisation et l'édition de colloques scientifiques, les divers rapports sur les candidatures, sur les articles scientifiques soumis, les demandes de financement, les projets de recherche ?
De cette activité multiforme, dévoreuse de temps mais indispensable à toute entreprise scientifique, je veux seulement me souvenir de trois actions inscrites dans le long terme et déjà citées : le lancement en France du programme de forages océaniques profonds en 1975 ; la création et l'animation, pendant 13 ans, du Groupe d'Etude de la Marge Continentale, de 1974 à 1987 ; enfin la création et la direction pendant 4 ans de l'Unité Mixte de recherche "Géosciences Azur", dont j'ai abandonné la responsabilité à la fin de 1999, juste avant mon départ en retraite.
( Retour )
Mais être universitaire, ce n'est pas seulement se comporter en animateur scientifique. La préparation des cours, la participation aux jurys de thèse et surtout la direction d'une équipe scientifique diversifiée obligent à élargir sa culture scientifique. L'importance de ce rôle se mesure aussi à notre capacité d'opérer des transferts d'une spécialité à une autre, même lorsque nous ne sommes pas créateurs des concepts et les inventeurs des données dont nous assurons la diffusion. J'ai cherché à faire mon métier de cette manière là aussi, en menant trois sortes d'action : l'écriture de livres ou d'articles à l'intention des étudiants et des professionnels de la Géologie ; la publication de synthèses cartographiques qui rendent accessibles à la communauté professionnelle tout entière des données jusque là éparpillées entre les mains des seuls spécialistes ; enfin les visites de « terrain » avec des collègues expérimentés, permettant au « marin » de garder un regard de naturaliste sur des objets d'étude qu'il risquait de ne plus voir qu'au travers d'images géophysiques. Parmi ces souvenirs de terrains, ceux associés à M. Lemoine dans les Alpes franco-italiennes me sont les plus chers.
Reste à évoquer l'effort de formation directe, quand le professeur s'adresse sans intermédiaire aux étudiants. Les élèves que j'ai contribué à former en second et troisième cycles universitaires ou en dirigeant leurs thèses sont pour la plupart dispersés dans les universités, au CNRS ou dans les compagnies pétrolières françaises ou étrangères. C'est à eux, non à moi, de dire si l'empreinte laissée par leur professeur et leur directeur scientifique fut superficielle ou profonde. Mais ce que je peux affirmer, c'est mon plaisir à enseigner, qui m'a toujours détourné de me porter candidat au CNRS, malgré la prédominance de mes activités de recherche et d'animation scientifique sur mon action plus strictement pédagogique.
J'ai été successivement assisté dans mon action administrative et gestionnaire par S. Dupont (Rennes), G. É nard et A.-M. Houlgard (Paris), et J. Gosselin (Villefranche). Bien que la fonction de « sous-directeur » n'ait jamais été identifiée dans notre organisation, je tiens à rendre hommage également à J.-P. Réhault, qui en a souvent assuré la charge à Villefranche quand les campagnes à la mer ou les réunions administratives ou scientifiques m'éloignaient du Laboratoire.
3. Les produits de la recherche personnelle et collective
Les années 60-70 : géologie de la Manche et de la plate-forme armoricaine
Ce chantier là est abandonné depuis longtemps. Du travail accompli en ces lointaines années, il reste, me semble-t-il, quelques idées issues de ma thèse : le rôle des régressions pléistocènes, qui ont provoqué l'exondation et le modelé de la plate-forme continentale tout entière, alors soumise à l'érosion karstique ou fluviale et aux actions périglaciaires ; le rôle actuel des organismes benthiques fixés, qui vivent sur des « fonds durs » balayés par les courants, et qui produisent des particules sédimentaires calcaires s'accumulant plus loin, dans des régions où décroît l'énergie des courants. Mais depuis le temps où je recueillais, avec le "Pluteus II", à partir de la Station Biologique de Roscoff, des milliers d'échantillons de sédiment meuble, où je prélevais en Manche occidentale les premiers témoins « en place » du Crétacé inférieur et de l'Eocène, où enfin je découvrais de nouvelles « fosses » creusées dans les terrains calcaires du Mésozoïque ou du Cénozoïque, beaucoup de progrès ont été accomplis dans la connaissance régionale, et aujourd'hui, mes activités de pionnier me semblent bien dépassées.
En revanche, demeure un document qui n'a pas vieilli : les cartes géologiques au 1/1000000 de la Manche (1974) et de la plate-forme bordant le Golfe de Gascogne (1976) déjà citées, couvrant au total une superficie égale au tiers de celle de la France.
Sous son couvert de sédiments meubles, la géologie de la plate-forme marine française était encore très mal connue à l'aube des années 70. Il était urgent d'en dresser une carte tant soit peu fidèle. Le CNEXO finança le projet, et me confia la charge de coordonner son exécution (acquisition des données en mer, le plus souvent sur des chalutiers loués ; rédaction de la carte en collaboration avec les producteurs de données). Œuvre ambitieuse, qui demanda un effort de plusieurs années et une mobilisation exceptionnelle de la communauté géologique nationale.
Il n'est pas possible d'énumérer tous les acteurs de l'entreprise, bientôt étendue à la Méditerranée. Qu'on imagine leur nombre d'après ces chiffres : 68250 km de profils sismiques enregistrés ; 4630 échantillons prélevés par carottage sur des affleurements rocheux, tandis qu'à terre, une pléiade de stratigraphes et de pétrologues œuvrait à assigner un âge et une appartenance géologique aux échantillons carottés. Parmi les collaborateurs, je ne cite que J.-P. Lefort, qui a cartographié le socle armoricain submergé, et Ph. Bouysse, qui a réunis et harmonisés les documents pour leur édition par le BRGM.
( Retour )
Le résultat de cet effort collectif n'est pas seulement l'agrandissement spectaculaire de la carte géologique de la France au 1/1000000. Une histoire géologique a aussi été écrite ou révisée, celle de la Manche, de la plateforme armoricaine et aquitaine jusqu'à Biarritz et, au-delà, celle de la plate-forme méditerranéenne. Du Permien au Néogène, se sont succédées des phases d'extensions horizontales et de serrages, de régressions et de transgressions marines, selon l'orientation des contraintes appliquées à la bordure de la plaque européenne et les variations du niveau océanique global.
Les années 70-80 : les Pyrénées submergées et émergées
Dans ces année-là, nous ne disposions toujours pas de navires modernes, ni à plus forte raison de submersibles de recherche. C'est à bord du « Job-ha-Zélian », vieux et court chalutier à peine transformé, que nous avons entrepris l'exploration géologique de la marge continentale nord-espagnole. Cette fois, ce fut un prélèvement heureux qui déclencha l'aventure : un échantillon de flysch crétacé supérieur prélevé en 1969 au nord des Asturies. Jusque là, nous pensions tous que le socle ibérique hercynien se continuait sur la marge, à peine recouvert d'un voile de sédiments meubles. Or, des flyschs crétacés sont plutôt une « signature » pyrénéenne et cantabrique.
De cet indice est né tout aussitôt le projet d'explorer systématiquement la plate-forme nord-espagnole, la seule partie de la marge qui nous fût accessible, en mettant en œuvre la méthode expérimentée un an plus tôt sur la plateforme armoricaine (combinaison de la sismique réflexion légère et du prélèvement d'échantillons rocheux à l'aide d'un carottier fonctionnant par simple gravité). Et c'est ainsi que, dès 1970, grâce à l'aide financière de la Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine et de son représentant E. Winnock, nous découvrions sous la mer, avec M. Lamboy, P.A. Dupeuble et les quelques étudiants rennais qui m'entouraient alors, une véritable chaîne plissée sous-marine longeant la côte espagnole depuis le Pays Basque jusqu'à La Corogne, constituée de sédiments crétacés déformés, érodés et recouverts en discordance par des couches éocènes et miocènes. L'évolution sédimentaire et structurale, l'orientation et l'organisation des structures dans cette chaîne montraient clairement qu'il s'agit d'un segment submergé du système pyrénéen. Du coup, la longueur des Pyrénées (au sens géologique du mot) était doublée, de la Méditerranée à l'Est jusqu'au Nord du Banc de Galice à l'Ouest, et un nouvel espace était ouvert à l'exploration pétrolière avec le succès que l'on sait.
Peut-être avions nous l'esprit d'escalier : le fait est que cela nous demanda presque deux ans pour renverser les termes de cette première conclusion (les Pyrénées se prolongent en mer), et pour la muer en une idée autrement plus féconde : la chaîne cantabrique et les Pyrénées émergées, situées dans le prolongement oriental de la marge nord-espagnole, doivent être interprétées comme le produit de l'affrontement d'anciennes marges continentales, rapprochées, plissées et soulevées hors de la mer à la suite de la convergence des plaques ibérique et eurasienne. Aujourd'hui, le concept de paléo-marges prises dans les chaînes plissées est devenu classique ; mais il a fallu de nombreuses années avant de l'imposer, surtout dans les Pyrénées…
La tectonique des plaques, alors à son matin, nous avait ainsi donné les moyens conceptuels d'interpréter nos observations : la marge nord-espagnole actuelle est héritée d'une marge passive mésozoïque brièvement transformée en marge active à l'aube du Tertiaire par la subduction de l'espace océanique du Golfe vers le Sud, sous l'Ibérie. Partant de là, nous avons proposé en 1977, avec R. Capdevila, que les Pyrénées émergées, qui prolongent vers l'Est la marge asturienne et basque, soient, elles aussi, le produit d'une subduction précédant la collision des plaques eurasienne et ibérique. Il nous semblait en effet que la continuité de la chaîne appelait une explication unique. Depuis quelques années, après l'enregistrement de profils sismiques au travers de la chaîne, l'idée d'une subduction pyrénéenne au Tertiaire paraît enfin acceptée. Toutefois, selon l'interprétation qui prévaut aujourd'hui, c'est la plaque ibérique qui a plongé vers le Nord, sous la plaque eurasienne, le long des Pyrénées émergées, et non l'inverse comme nous le pensions à l'image de ce qui s'est produit au Sud du Golfe de Gascogne. Ce qui ne va pas sans poser le problème du raccordement en Pays Basque de deux subductions en sens inverses. Mais l'image actuelle n'est-elle pas celle d'un rétrocharriage tardif ?
Enfin, toujours dans les années 70, avec la petite équipe que j'avais rassemblée à Rennes, nous n'avons pas seulement regardé vers l'Est, du côté des Pyrénées : nous avons aussi été emportés par notre élan au delà de la marge nord-espagnole vers l'Ouest et vers le Sud. En trois ou quatre campagnes, combinant, comme nous l'avions fait en Manche et sur la plateforme du Golfe, sismique légère et carottages de roche, nous avons dressé la carte géologique du plateau continental portugais et esquissé celle du Golfe de Cadix. C'était l'ouverture d'un nouveau chantier scientifique, exploité plus tard par J. Malod et D. Mougenot.
( Retour )
A cette époque, toute donnée de géologie sous-marine était neuve, et faisait surgir des idées originales. Le rôle des accidents « tardi-hercyniens » dans la mobilité de la marge ibérique depuis sa naissance jusqu'à ses conséquences dans la morphologie actuelle nous fut révélé par l'étude des grands canyons sous-marins de Saint Vincent, Setubal, Lisbonne et surtout de Nazaré. Là, nous observions comme au Nord de la péninsule mais avec une intensité moindre, des effets d'une divergence au Mésozoïque, puis d'une convergence au Cénozoïque, entre l'Ibérie, l'Eurasie et l'Afrique. D'une certaine manière et à une autre échelle, l'étude de l'écaille chevauchante de Nazaré, issue d'un décrochement d'âge permo-carbonifère remobilisé au Secondaire et inversé au Tertiaire, nous ramenait aux Pyrénées.
Les années 80-90 : les fonds océaniques constitués de péridotite serpentinisée
L'histoire de cette découverte commence en 1978, pendant la campagne Hespérides du navire océanographique « le Noroit ». Il s'agissait alors d'obtenir par sismique réflexion des images de la marge continentale passive située à l'Ouest de la Galice, dans le proche Atlantique, et d'y prélever par dragage et carottage des échantillons rocheux pour identifier les terrains qui apparaissent sur ces images. Cette région avait été choisie parce que la couverture sédimentaire meuble y est mince et discontinue, ce qui devait permettre d'atteindre plus facilement qu'ailleurs les terrains constituant l'ossature de la marge.
Au plus profond de cette marge, à quelques trois cent cinquante kilomètres de la côte espagnole et à plus de 5000 m de profondeur, là où l'on pensait que s'effectuait le passage entre la croûte continentale amincie (les fonds du premier type) et la croûte océanique basaltique (les fonds du deuxième type), un petit relief avait été repéré : une colline sous-marine de 200 mètres de hauteur, nommée "colline 5100" d'après la cote de son sommet. Il pouvait s'agir d'un témoin avancé de la croûte basaltique de l'Atlantique, du dernier bloc continental de la marge galicienne, ou bien encore d'un diapir de sel issu des formations sédimentaires mises en place il y a plus de 120 millions d'années dans la déchirure naissante entre l'Amérique et l'Europe. Pour lever l'indétermination, il fallait tenter un prélèvement de roche par dragage sur un des versants de la colline. Mais draguer à une telle profondeur en visant une cible aussi réduite est une opération délicate. Une première tentative, lors d'une campagne précédente, avait échoué. Aussi la surprise fut-elle heureuse quand la drague remonta pleine d'argile compacte, qui ressemblait au produit d'altération d'une roche cristalline.
Il fallut des mois et le concours de plusieurs spécialistes, parmi lesquels J. Kornprobst, pour reconnaître enfin dans notre échantillon les restes d'une péridotite. La roche, exposée sur le fond sous-marin depuis des dizaines de millions d'années, avait été transformée en serpentinite, puis en argile au contact de l'eau de mer ; mais sa nature originelle était reconnaissable en dépit des altérations subies. Ainsi, à la frontière entre la marge continentale de l'Ibérie et l'Océan Atlantique, ce n'est ni la croûte continentale, ni la croûte océanique classique qui semble former le substratum des sédiments à l'endroit où s'élève la colline 5100, mais un fond d'un troisième type, constitué de terrains issus du manteau.
À vrai dire, un seul prélèvement par dragage ne pouvait constituer à lui seul une preuve décisive de l'existence de ce type de fond, et les esprits sceptiques ne manquaient pas, qui pensaient que nous avions seulement prélevé un échantillon de péridotite altérée appartenant à la ceinture ophiolitique hercynienne de l'Ibérie. Mais l'indice fut jugé suffisamment intrigant pour que fût acceptée notre proposition de forage présentée devant le Comité de programmation de l' "Ocean Drilling Program" (O.D.P.). C'est ainsi que, au printemps 1985, sept ans après la campagne Hespérides, le navire foreur JOIDES Resolution assembla son train de tiges un peu au Nord de la colline 5100 (campagne O.D.P. 103 ; la troisième seulement avec ce navire-là). Le 2 mai, le trépan toucha la roche dure à 5500 m sous la coque du bateau, une roche effectivement composée de péridotite serpentinisée. Le résultat du dragage était donc confirmé.
Il restait à vérifier que les serpentinites carottées provenaient bien de terrains mantelliques, et non d'ophiolites hercyniennes, et qu'elles n'affleuraient pas seulement sur la colline 5100, mais plus largement le long de la bordure continentale de la Galice. Le premier objectif fut très vite atteint par les études structurales, pétrologiques et géochimiques engagées dès la fin de la campagne par J. Girardeau, G. Féraud et U. Schärer et quelques autres : nos serpentinites étaient indiscutablement des témoins du manteau terrestre, transportés au Crétacé inférieur depuis la profondeur d'environ 30 km jusqu'en surface, à l'axe du rift continental qui séparait alors Terre-Neuve de l'Ibérie. Mais pour atteindre le second objectif, c'est à dire étendre la découverte à d'autres sites, il fallut attendre les résultats d'une nouvelle mission en mer, la campagne « Galinaute », exécutée un an plus tard. Cette fois, l'outil de la recherche était le submersible le Nautile. En cinq plongées, entre 5300 et 3000 m de profondeur, des péridotites serpentinisées furent prélevées en de nombreux endroits, tous localisés au nord de la colline 5100 et à la frontière de la marge ibérique et de l'Océan Atlantique. Ainsi les résultats du dragage de 1978 et du forage de 1985 étaient-ils étendus à une vaste région, avant que d'autres campagnes de forages, quelques années plus tard, élargissent encore, vers le sud cette fois, la zone d'affleurement des terrains mantelliques.
( Retour )
La recherche des explications est sans doute encore plus fascinante que la collecte des données. La datation des déformations subies par les péridotites avaient montré que leur cheminement vers la surface s'était produit au Crétacé inférieur, au stade « rifting » de l'évolution de la marge, juste avant l'ouverture de l'océan Atlantique. Pour en comprendre les causes et les modalités, il fallait donc regarder de plus près ce qui ce passe au cœur des rifts continentaux, ces précurseurs des océans. Là, on avait observé depuis quelques années déjà que certains terrains métamorphisés en profondeur sont mis à jour par le jeu de failles normales très peu inclinées par rapport à l'horizontale (les « failles de détachement »), un peu comme se découvre une carte à jouer en faisant glisser latéralement la carte qui la surmonte. Pour expliquer l'affleurement des terrains du manteau à l'axe de ces mêmes rifts, nous avons donc proposé de généraliser ce modèle en changeant d'échelle et en reprenant une idée de B. Wernicke : si la faille de détachement (ou le faisceau de failles de détachement) traverse toute la croûte et s'enracine dans le manteau, la mise a nu des péridotites devient possible. L'hydrothermalisme océanique fait le reste, en transformant les péridotites en serpentinites.
Notre modèle provoqua naturellement de nombreuses controverses, le retour en mer de plusieurs équipes françaises et étrangères pour y recueillir d'autres échantillons, d'autres images géophysiques. Le schéma un peu simpliste du début fut retouché, compliqué pour tenir compte des contraintes imposées par de nouvelles données, et par des expériences en laboratoire sur modèles réduits entreprises par M.-O. Beslier et J.-P. Brun. Mais aujourd'hui l'idée de la dénudation tectonique du manteau par l'extension horizontale de la lithosphère est universellement admise. Un nouveau chapitre de la géodynamique des rifts continentaux et de l'ouverture, puis de l'accretion océaniques a ainsi été écrit en vingt ans. Et dans cette aventure, tout n'est pas venu de l'océan actuel : nous avons aussi recherché les témoins des fonds océaniques à serpentinite en bordure des anciennes marges passives prises dans les chaînes plissées. Nous l'avons fait dans les Pyrénées, en parcourant les affleurements de Lertz ; nous l'avons surtout fait dans les Alpes, avec M. Lemoine, P. Tricart et N. Froitzheim, en visitant les serpentinites recouvertes de radiolarites oxfordiennes aujourd'hui perchées sur les sommets du Queyras ou dans les montagnes helvétiques. Nous en avons conclu que nombre de chevauchements d'ophiolites résultent dans les Alpes de l'inversion au Cénozoïque d'anciennes failles de détachement actives lors de l'ouverture de la Téthys.
Depuis les années 80, plusieurs autres lieux où affleure en pied de marge le manteau sous-continental ont été signalés dans l'océan global, notamment au sud de l'Australie. Le cas de la marge de Galice est donc loin d'être une exception. Conforté par cette généralisation de nos premières observations, j'ai proposé d'aller plus loin encore en étendant le modèle à l'océan tout entier : des serpentinites issues du manteau affleurent aussi le long des dorsales océaniques « lentes », tandis que, sur certaines images sismiques de la croûte née de ces dorsales, apparaissent des réflecteurs faiblement inclinés pouvant être rapportés à d'anciens détachements. D'où l'hypothèse selon laquelle la lithosphère crée à l'axe des dorsales lentes résulte principalement d'une « accrétion tectonique », contrairement à ce qui se produit à l'axe des dorsales rapides où prédomine l'« accrétion magmatique ».
Pourtant, toutes les implications de la découverte initiale n'ont sans doute pas encore été clairement perçues. L'une d'elles, à mon avis très importante, est la clarification du concept de croûte et de manteau, au moins dans les domaines marins. Au début du vingtième siècle, ces deux enveloppes de notre globe ont reçu une définition sismique : tous les étudiants savent que le Moho qui les sépare est la frontière entre les terrains où la vitesse des ondes P est inférieure ou supérieure à 8,1 km/s. Mais au fil des années, les géologues, qui ont voulu identifier croûte et manteau à des roches bien définies, ont peu à peu substitué à la définition première une autre fondée sur la nature des terrains, en donnant à leur interprétation la valeur d'un postulat : par exemple, en domaine océanique, sont réputés crustaux les basaltes et les gabbros rencontrés au fond des océans, tandis que les péridotites serpentinisées qui leurs sont souvent associées sont classiquement attribuées au manteau. Or ces roches sont parcourues par les ondes P à des vitesses bien inférieures à 8,1 km/s, en raison de leur teneur en eau. Elles appartiennent donc à la croûte, au sens géophysique et originel du mot. Dans le cas de la marge ibérique que nous avons étudié, les données de sismique grand angle, ou, plus simplement, un calcul isostatique simple tenant compte de la profondeur du fond marin, de l'épaisseur sédimentaire, de la gravimétrie régionale et de la densité respective des péridotites altérées et des péridotites fraîches, montrent que, au voisinage de la montagne 5100, les serpentinites forment une couche épaisse de plusieurs kilomètres. La vitesse des ondes P y croît avec la profondeur, sans doute en relation avec une diminution de la teneur en serpentines et avec l'éloignement de la source en eau (l'océan) au moment de l'activité hydrothermale.
Ainsi le Moho, dans ce cas, n'est pas le contact entre roches réputées crustales ou mantelliques par les géologues, mais la surface de changement de phase serpentinite-péridotite. Une surface coïncidant probablement, au moment de la serpentinisation, avec l'isotherme de 500-600 °C, dont on sait par ailleurs qu'elle constitue une barrière thermique pour la formation des serpentines. Inversement, les données sismiques qui situent le Moho à 7 ou 8 km sous la surface de la croûte dans les régions où affleurent des serpentinites suggèrent fortement que c'est à ces profondeurs que se situait cette isotherme à l'axe de la dorsale lente, quand agissait l'hydrothermalisme « chaud ». Ce Moho d'un genre nouveau est d'ailleurs potentiellement mobile : si, dans l'histoire géologique, la température de la lithosphère s'élève, alors il remontera ; il s'abaissera au contraire sous l'effet d'un refroidissement, du moins si un hydrothermalisme local permet la serpentinisation en profondeur. Ainsi, la croûte océanique crée à l'axe des dorsales lentes est-elle constituée en grande partie de terrains certes issu du manteau, mais par transformation hydrothermale et non par la seule fusion partielle comme on le pense classiquement.
( Retour )
Si l'on revient aux marges stables, c'est à dire à mon domaine de recherche, se pose une autre question : là où l'amincissement crustal dépasse 8 km, c'est à dire au plus profond d'une marge stable, on peut s'attendre à ce que la serpentinisation affecte le toit et la couche sommitale du manteau. En ce cas, le contact (tectonique : l'ancien détachement) croûte continentale (amincie) et manteau (serpentinisé) se trouvera reporté en position intra-crustale (sismiquement parlant). L'image de ce contact a été décrite par L. Montadert et ses collègues dès le milieu des années 70 aux pieds des marges celtique et galicienne : il s'agit du célèbre réflecteur S, qui trouve ainsi son explication dans le contraste de densité entre les deux sortes de terrains (serpentinite et croûte continentale amincie) séparés par la faille de détachement inactive depuis la rupture entre l'Amérique et l'Eurasie.
Enfin, ultime conséquence, mise en lumière avec N. Froitzheim : l'observation en submersible (1995) du contact tectonique croûte continentale-manteau serpentinisé au pied du Banc de Galice a montré la présence entre les deux sortes de terrains d'un mélange tectonique comprenant des mylonites de gabbro, et, à son sommet, des brèches à serpentinite ; d'où l'idée que les « ophicalcites » qui recouvrent les ophiolites ou la croûte océanique actuelle sont aussi les restes d'un mélange tectonique « froid » plus ou moins remanié, et que les fonds marins présents ou fossiles où on les trouve peuvent s'interpréter comme des surfaces structurales héritées d'anciens détachements.
On le voit, le trait de drague de 1978 a ouvert des perspectives tout à fait inattendues, qui s'étendent bien au delà de l'étude régionale que nous menions alors…
Résumé et conclusion
Au terme d'un parcours de plus de quarante ans, quel bilan dresser de ma production scientifique ? Il n'est pas facile à un chercheur de présenter ses travaux sans vanité ni erreur de perspective. Je m'y suis risqué cependant. Dans cette conclusion, je me limite à énumérer ce qui me semble l'essentiel, c'est-à-dire les concepts nouveaux ou renouvelés qui ont eu un impact sur la science géologique en général, et aux données de géologie régionales mises à la disposition de la communauté scientifique par des cartes.
1. Les données géologiques régionales en effet sont difficilement accessibles si elles ne sont pas présentées sous une forme graphique. Mes premières cartes donnent la répartition des sédiments en Manche occidentale (1960-1964). Les suivantes, établies en collaboration avec de nombreux collègues et Institutions, décrivent au 1/1000000 la géologie de la plate-forme continentale de la Manche (1974), du Golfe de Gascogne (1976), enfin du Portugal (1978). J'ai décrit cette entreprise lourde et de longue haleine, qui mobilisa, au delà de l'équipe qui m'entourait alors, une large communauté nationale, et qui demanda plusieurs années et de très nombreuses campagnes à la mer. La carte géologique de la France au 1/1000000, telle qu'on la voit aujourd'hui élargie à la plate-forme continentale, est le fruit de cet effort collectif que l'on m'avait donné pour mission de coordonner.
2. Le premier bloc basculé de marge continentale stable décrit dans la littérature scientifique est celui dont le sommet forme le « Banc Le Danois », au sud du Golfe de Gascogne (1971). J'ai également évoqué la belle carrière de ce concept, appliqué d'abord à l'analyse des images sismiques des marges actuelles, et rapidement généralisé aux marges fossiles prises dans les chaînes de collision où les « blocs » sont inversés et transformés en écailles ou en nappes. Les Pyrénées m'en donnèrent la première illustration (1977), en introduisant ainsi le concept d'« inversion tectonique » avant les mots. Aujourd'hui, l'idée, qui rend compte de la troublante coïncidence dans les chaînes entre les zones paléogéographiques (au temps de la sédimentation sur la marge) et structurales (au temps de l'inversion des unités tectonique héritées du rift), pourtant d'âges très différents (respectivement : temps de la naissance et temps de la mort de l'océan), est entrée dans le corpus scientifique de la géologie.
3. Enfin j'ai énuméré les implications scientifiques de la découverte d'un affleurement de serpentinite (1980) sur la « colline 5100 », au pied de la marge espagnole de Galice. L'observation, bientôt généralisée à toute la marge ouest-ibérique, est à l'origine du développement d'un autre concept novateur : celui de la dénudation tectonique du manteau par le jeu des « failles de détachement » lithosphériques lors de l'ouverture d'un océan. Sur plusieurs kilomètres d'épaisseur, les péridotites ainsi mises en contact avec l'eau de mer sont alors serpentinisés par l'hydrothermalisme océanique, constituant ce que j'ai nommé en 1987 les « fonds sous-marins de troisième type ». On admet aujourd'hui que cette « accretion tectonique » est le principal moteur de l'expansion aux dorsales lentes, et que les serpentinites, associées ou non à des gabbros, constituent l'essentiel de la « croûte océanique » crée dans ces conditions. On sait aussi que les anciennes failles de détachement actives au moment de l'ouverture océanique sont de bons candidats à devenir dans les chaînes plissées des chevauchements majeurs par inversion tectonique.
( Retour )
Attaché à décrire mon parcours personnel, je n'ai sans doute pas rendu assez justice à mes compagnons de route. J'en ai cité quelques-uns au passage dans les pages précédentes. L'aide des « marins », je veux parler de ceux qui m'ont accompagné sur les navires océanographiques et dont le nom se trouve accolé au mien dans les publications scientifiques, m'a été particulièrement précieuse, indispensable même. Par ordre d'apparition : M. Gennesseaux, P. Muraour, L. Cabioch, J.-P. Le Gorgeu, R. Horn, J.-R. Vanney, Ph. Bouysse, F. Le Lann, L. d'Ozouville, M. Lamboy, J.-C. Sibuet, A. Rousseau, J.-P. Lefort, A. Cressard, J.-P. Leprètre, I. Hennequin, P. Musellec, D. Mougenot, Ph. Baldy, R. Capdevila, J.-P. Gérard, J. Malod, A. Mauffret, G. Auxiètre, J.-P. Dunand, S. Grimaud, F. Gonzales-Lodeiro, J.-R. Martinez-Catalan, C. Lepvrier, G. Mascle, D. Derégnaucourt, J. P. Réhault, J. Mascle, D. Témime, M. Cousin, E.-L. Winterer et l'équipe embarquée du « Leg » ODP 103, J. Girardeau, J.-P. Loreau, M. Moullade, M. Comas, J. Kornprobst, M. Thommeret, M.-O. Beslier, M. Ask, V. Gardien, J. Gil-Ibarguchi, G. Cornen, N. Froitzheim, et tant d'autres venus m'aider et me soutenir de leur enthousiasme seulement le temps d'une campagne. L'équipe technique de Villefanche (J.-P. Digonnet, A. Moreau) n'était pas moins essentielle au succès des campagnes menées par le groupe avant que le relai ne fût pris par les équipes de l'IFREMER.
Revenu à terre, le géologue marin doit faire appel à une multitude de spécialistes pour exploiter au mieux les données qu'il a recueillies en mer. Je dois beaucoup aux nombreux collègues qui ont signé avec moi et avec les « marins » énumérés plus haut les articles rendant compte de nos recherches. Par ordre d'apparition encore : Y. Le Calvez, P. Marie, G. Millot, J. Valérien, G. Bouhot, A. Barthe, R. Deloffre, S. Duplaix, P. Andreieff, E. Buge, P.-A. Dupeuble, M. Durand-Delga, P.-Y. Berthou, J. Mergoil-Daniel, G. Torrent, C. Muller, J. Taugourdeau-Lantz, M. Lemoine, M. Recq, P. Tricart, M.-F. Brunet, G. Féraud, Y. Lagabrielle, J. Murillas, B. Mamet, C.-M. Krawczyk, D. Rappin, T. Reston, U. Schärer, P. Agrinier, A. Bitri, S. Charpentier, B. Fuegenschuh.
À elle seule, cette double énumération, certainement incomplète, montre le caractère collectif de la recherche, et la difficulté, pour un chef de projet ou de mission, de rendre compte avec quelque objectivité de sa contribution personnelle.
G. B.

( Retour )